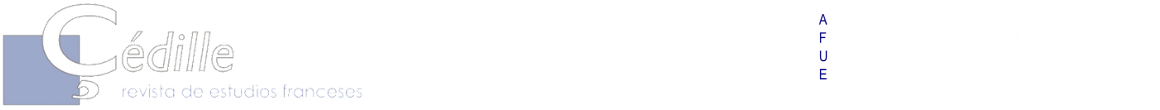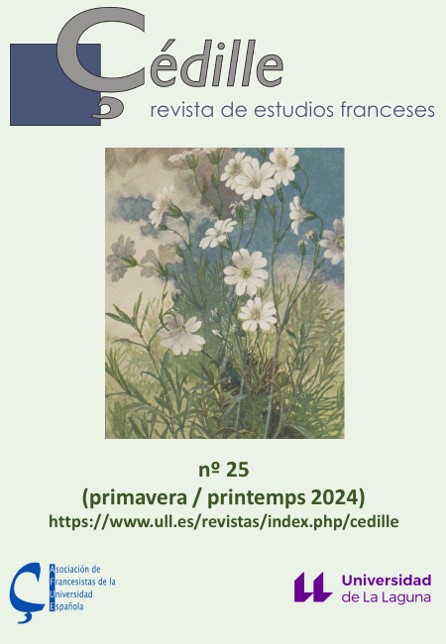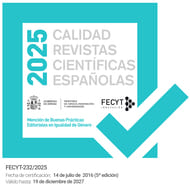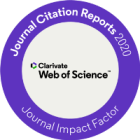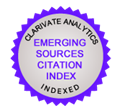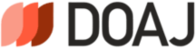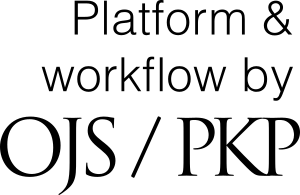<i>Sachant que</i> : un marqueur (plus ou moins juste) de mémoire sémantico-discursive
Resumen
Construcción con valor epistémico, sachant que es un marcador discursivo que abarca tanto valores semántico-lógicos como discursivo-argumentativos. Nuestro artículo se propone seguir el comportamiento de este marcador a través de un corpus heterogéneo desde el punto de vista de la tipología textual (textos literarios, de discurso corriente) pero también en el lenguaje jurídico (en formato escrito y oral). El interés de analizar este marcador reside en el hecho de que sus usos, muy frecuentes en el francés contemporáneo, tienden a diluir el valor epistémico inicial, que remite a un contenido conocido y compartido por las instancias enunciativas. Queremos seguir el mecanismo de debilitamiento o mantenimiento de la fuerza semántica y argumentativa de esta unidad discursiva en los distintos tipos de discurso, con el fin de identificar el uso correcto de la lexía en contextos apropiados y con el sentido adecuado.
Citas
ABEILLÉ Anne & Danièle GODARD [dir.] (2021) : La Grande Grammaire du Français (GGF). Arles, Actes Sud. URL : www.grandegrammairedufrançais.com.
ÁLVAREZ-PRENDES, Emma (2023) : « Aperçu de l’expression linguistique de la certitude en français: le cas de certainement ». Anales de Filología Francesa, 31. DOI : https://doi.org/10.6018/analesff.571001
ANSCOMBRE, Jean-Claude (2000) : « Un problème de sémantique lexicale : l’interprétation active/passive des adjectifs verbaux participes en position d’épithète ». Études Romanes, 45, 237-259.
ANSCOMBRE, Jean-Claude (2015) : « Les parémies : variantes, matrices lexicales et fa-milles parémiques », in S. Berbinski (éd.), Figement et imaginaire linguistique. Bu-carest, Editura Universității din Bucureşti.
ANSCOMBRE, Jean-Claude & Oswald DUCROT (1983) : L’argumentation dans la langue. Bruxelles, Mardaga.
BERBINSKI, Sonia (2007a) : Négation et antonymie – de la langue au discours. Bucarest, Editura Universității din Bucureşti.
BERBINSKI, Sonia (2007b) : « Le défigement entre la langue et le discours ». Lingvistica [s.n.], 249-270.
BERBINSKI, Sonia (2008) : Antonymie – phénomène discursif. Bucarest, Editura Univer-sității din Bucureşti.
BERBINSKI, Sonia (2019) : De l’approximation. De „à peu près” à „cam așa ceva”. Frankfut am Main, Peter Lang.
BONNARD, Henri (2001) : Les trois logiques de la grammaire française. Bruxelles, Duculot.
BORILLO, Andrée (1982) : « Deux aspects de la modalisation assertive : croire et savoir ». Langages 67, 33-53. URL : https://www.persee.fr/doc/lgge_0458-726x_1982_num_16_-67_1970.
BRUNOT, Ferdinand (1905) : Histoire de la langue française des origines à 1900. Tome 1, Paris, Armand Colin. URL : https://archive.org/details/HistoireDeLaLangueFranaise/-page/n245/mode/2up?view=theater
CHARAUDEAU, Patrick (1992) : Grammaire du sens et de l’expression. Paris, Hachette Édu-cation.
CARVALHO, Paulo de (2003) : « Gérondif, participe présent et adjectif déverbal en morpho-syntaxe comparative ». Langages, 149, 100-126. DOI : https://doi.org/10.3406/lgge.¬2003.2435
DUCROT, Oswald (1968) : « La description sémantique des énoncés français et la notion de présupposition ». L’Homme 8 : 1, 37-53.
DUCROT, Oswald (1972) : Dire et ne pas dire. Paris, Hermann.
DUCROT, Oswald (1980) : Les mots du discours. Paris, Les Éditions de Minuit.
DUCROT, Oswald (1982) : « La notion de sujet parlant ». Recherches sur la philosophie et le langage, Grenoble, Université de Grenoble, 65-93.
DUCROT, Oswald (1990) : « Argumentation et persuasion » [préprint]. Colloque Énon-ciation et parti-pris, Anvers.
DUCROT, Oswald (2015) : « Argumentation et persuasion », in Georges Roque, Ana Laura Nettel, Persuasion et argumentation, Paris, Classiques Garnier, 221-239.
ÉGRÉ, Paul (2005) : « Savoir, croire et questions enchâssées ». Public@tions Electroniques de Philosophi@ Scienti@e 2, 1-20.
FOULLIOUX, Caroline (2003) : « Le mode verbal et l’atténuation : À propos de devoir ». Thélème, Revista Complutense de Estudios Franceses, número extraordinario, 109-120.
FUCHS, Catherine (1996) : Les ambiguïtés du français. Paris, Ophrys.
GALATANU, Olga (2018) : La sémantique des possibles argumentatifs : génération et (re)construction discursive du sens linguistique. Bruxelles, Peter Lang.
GARRIGOU, Alain (2021) : Ce que « sachant » veut dire. URL : https://blog.mondediplo.net/ce- que-sachant-veut-dire
GOSSELIN, Laurent (2010) : Les modalités en français : la validation des représentations. Amsterdam/New York, Rodopi.
GOSSELIN, Laurent (2014) : « Sémantique des jugements épistémiques ». Langages 193, 63-81.
GOSSELIN, Laurent (2019) : « Marqueurs de modalité épistémique et calcul des valeurs modales : sémantique de savoir que », in Catherine Filippi-Deswelle (éd.) Quinze études de cas sur les modalités linguistiques, Université de Rouen, 115-130. URL : http://eriac.univ-rouen.fr/wp-content/uploads/2020/02/05ECMLp115Gosselin.pdf
GREVISSE, Maurice (1996) : Le Bon usage. Bruxelles, De Boeck Duculot.
GRICE, H. Paul (1979) : « Logique et conversation ». Communications, 30, 57-73.
GUILLAUME, Gustave (1929 [1984]) : Temps et verbe. Théorie des aspects, des modes et des temps suivi de L’architectonique du temps dans les langues classiques. Paris, Honoré Champion.
GUILLAUME, Gustave (1974) : Leçons de linguistique 1949 – 1950 : Structure sémiologique et structure psychique de la langue française II, publiées par Roch VALIN. Québec et Paris, Les Presses de l’Université Laval et Librairie Klincksieck.
GUIMIER, Claude et al. (1993) : 1001 circonstants. Caen, Presses Universitaires de Caen.
HALMØY, Odile (1984) : Le gérondif en français. Paris, Ophrys.
HALMØY, Odile (2003) : « À propos de l’adjectif en –ant, dit ‘‘verbal’’ ». Revue Romane, 19:1, 48-64.
HASPELMATH, Martin & Ekkehard KÖNIG (1995) : Converbs in Cross-Linguistic Perspec-tive. Structure and Meaning of Adverbial Verb Forms - Adverbial Participles, Ger-unds. Berlin et New York, Mouton de Gruyter. DOI : https://doi.org/10.1515/9783110884463
KARTTUNEN, Lauri (1973) : « La logique, des constructions anglaises à complément pré-dicatif ». Langages 30, 56-80.
KIPARSKY, Paul & Carol KIPARSKY (1971) : « Fact », in D. D. Steinberg & L. A. Jakobo-vits (éds), Semantics. An Interdisciplinary Reader in Philosophy, Linguistics, and Psy-chology, Cambridge, Cambridge University Press, 345-369.
LEWIS, David (1979): « Scorekeeping in a Language Game ». Journal of Philosophical Log-ic, 8, 339-359. DOI : 10.1007/BF00258436
MARTIN, Robert (1983) : Pour une logique du sens. Paris, Presses Universitaires de France.
MARTIN, Robert (1987) : Langage et croyance. Les « univers de croyance » dans la théorie sémantique. Bruxelles, Mardaga.
MARTINET, Hanne (1979) : « Les épithètes en –ant en français contemporain ». La lin-guistique, [s.n.], 58-68.
MILNER, Jean-Claude (1982) : Ordres et raisons de langue. Paris, Seuil.
MOESCHLER, Jacques (1992) : « Une, deux ou trois négations? ». Langue française, 94, 8-25. URL : https://www.persee.fr/doc/lfr_0023-8368_1992_num_94_1_5799
NØLKE, Henning (1994) : « La dilution linguistique des responsabilités. Essai de description polyphonique des marqueurs évidentiels il semble que et il paraît que ». Langue française, 102, 84-93.
PAVEAU, Marie-Anne (2006) : Les prédiscours. Sens, mémoire, cognition. Paris, Presses Sor-bonne nouvelle.
PELLINGHELLI, Sylvie (2013) : « Les effets juridiques de la notion économique de profes-sionnel ». Revue juridique de l’Ouest, n° spécial, 9-23. URL : https://www.persee.fr/-doc/juro_0990-1027_2013_hos_26_1_4751
SALLES, Mathilde (2010) : Que présuppose l’anaphore dite présuppositionnelle ? Sur la coréfé-renciation des expressions nominales complètes. Cambridge, Cambridge University Press.
SAUSSURE, Louis (de) (2018) : « Des présuppositions stricto sensu aux présuppositions discursives ». La Présupposition, entre théorisation et mise en discours, 35-56. DOI : 10.15122/isbn.978-2-406-06648-4.p.0035
SCHNEDECKER, Catherine (2012) : « Tout le monde, tous, (tous) les gens : relations sémantiques entre des expressions dénotant la totalité /+hum/ », in N. Le Quer-ler, F. Neveu & E. Roussel (éds), Relations, connexions, dépendances. Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 127-155.
SPERBER, Dan & Deirdre WILSON (1989) : La pertinence : communication et cognition. Paris, Minuit.
TULVING, Endel (1972): « Episodic and semantic memory », in E. Tulving & W. Don-aldson, Organization of memory. New York, Academic Press, 381-403.
TUȚESCU, Mariana (1998) : L’Argumentation. Bucarest, Editura Universității din București.
TUȚESCU, Mariana (2005) : L’auxiliation de modalité. Dix auxi-verbes modaux. Buca-rest, Editura Universității din București.
VATRICAN, Axelle (2012) : « Savoir que et la notion de présupposition ». Langages, 186, 69-84.
VELICU, Anca-Marina (2005) : « Le programme minimaliste de la Grammaire Généra-tive : retour à la philosophie dérivationnelle ». Dialogos, 12, 103-122.
VET, Co (1994) : « Savoir et croire ». Langue française, 102, 56-68.
WILMET, Marc (1997) : Grammaire critique du français. Paris, Hachette.
Derechos de autor 2024 Çédille, revista de estudios franceses

Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento 4.0.